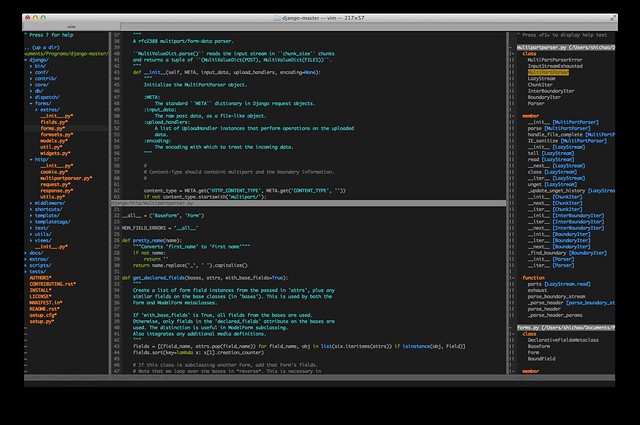J’avais promis dans un précédent billet de commenter rapidement mes prophéties sur le collégien du futur. Je l’avoue, c’était une promesse de Gascon (une spécialité locale ici 😉 ) ; sept mois plus tard, les bribes de ce billet de commentaire restaient paresseusement alanguies dans mon moleskine et, comme personne ne s’en était ému, moi aussi je jouissais avec indolence de cette impunité. Mais voici que quelqu’un a lu mon billet et fait remarquer que j’ai manqué à ma parole ! Je suis pris la main dans le sac et comme le sycophante n’est autre qu’Eric Delcroix dont je suis les publications depuis… longtemps… je ne pouvais plus ne pas publier ce billet. Le voici donc remis à jour aujourd’hui.
Nous sommes en effet à mi-parcours (ce texte d’avril 2006 essayait d’imaginer ce que serait la vie d’un collégien 10 ou 15 ans plus tard). Dans quelle mesure la vie d’un collégien de 2014 correspond-elle à ce que j’avais imaginé ? Une des prophéties s’est assurément réalisée (mais sur celle-ci je n’avais guère de doutes) : mon fils est entré en 6ème cette année et je me trouve donc avoir un spécimen de collégien tout frais à examiner.
NB : Il ne s’agit pas de savoir si j’avais raison, si « j’avais vu juste ». Ce point n’est pas très important (sauf si un jour j’envisage de m’installer comme voyant ; dans ce cas mes lecteurs seront les premiers informés, naturellement 😉 ) d’autant que je n’aurais pas la prétention de soutenir que mes propositions étaient très originales. Il est plutôt question de savoir si le numérique et ses usages par les jeunes ont évolué comme on pouvait le prévoir alors ou si des révolutions inattendues ont eu lieu en ce domaine.
Ce qui s’est confirmé
En premier lieu, il faut reconnaître que les smartphones se sont généralisés (le premier iphone est sorti presque un an après la publication de mon billet. Essayez de vous souvenir de ce qu’était un smartphone en 2006… Un article de décembre 2006 donne le top 3 des smartphones de l’année : le Nokia E61 (voir photo), le Blackberry Pearl 8100 et le Motorola MING A1200). Désormais, à peu près tous les téléphones mobiles ont les fonctionnalités que j’évoquais : navigation web, fonctions multimédia etc.

De même les fonctions de géolocalisation sont maintenant largement disponibles sur les terminaux et des applications en tirent profit pour proposer des notifications liées au lieu où se trouve l’utilisateur : on pense évidemment à Foursquare, qui envoie des notifications sur les contacts qui sont à proximité, sur les offres des commerçants proches, sur les commentaires associés à un lieu. Cet exemple est le plus caractéristique et le plus proche de ce que j’évoquais (le téléphone indique à Théo qu’un de ses amis est à proximité) mais on peut aussi penser à la légion d’applications qui permettent de trouver les (restaurants|musées|toilettes|…) les plus proches de l’endroit où on se trouve ou qui utilisent la géolocalisation pour apporter des informations sur un lieu (certaines applications de réalité augmentée, guides de musées…) Je peux même régler mon téléphone pour que le réveil ne sonne que quand je suis dans un lieu donné !
Un autre point est confirmé, c’est l’importance qu’a conservé le papier dans le travail du collégien :
Le cartable d’un collégien sera beaucoup plus léger, dans dix ans ; il lui servira à transporter quelques feuilles de papier et de quoi écrire, mais son instrument le plus important sera son téléphone portable.
Et même, contrairement à ce que j’avais imaginé, les élèves de collèges n’en sont pas à prendre des notes sous forme numérique en classe et les cartables ne sont guère plus légers qu’ils n’étaient à l’époque.
De même, l’évolution de l’utilisation du courrier électronique est à peu près celle que j’avais dite : les jeunes utilisent très peu, et de moins en moins, ce moyen de communication et ils le perçoivent comme un « truc de vieux ». Les exemples sont nombreux :
- La société Atos, sous l’impulsion de ses jeunes salariés (son personnel est en grande partie constitué de consultants en début de carrière), a décidé en 2011 de supprimer tous les courriels internes avant 2014 ; un réseau social d’entreprise a été mis en place pour remplacer cet outil. Même s’il semble que ces ambitions aient été fortement revues à la baisse depuis, cette annonce montre bien la vigueur de la tendance contre le courrier électronique dans notre société.
- Un enseignant mon confiait un jour que lorsqu’il cherchait à obtenir les adresses électroniques de ses élèves, beaucoup n’en avaient pas ou ne les consultaient pas. Pourtant, comme il le fait remarquer, tous ou presque sont utilisateurs de Facebook et cette plateforme nécessite une adresse email pour créer un compte (et c’est même cette adresse qui est utilisée comme identifiant de connexion).
Il est vrai que les courriels ne sont pas devenus payants. Toutefois, un hébergeur m’a dit, il y a déjà quelques années, que la gestion du courrier électronique constituait la première source de coût pour son entreprise (gestion des serveurs exigeant une puissance de calcul et un espace de stockage de plus en plus importants, logiciels destinés à lutter contre les abus et les attaques, support utilisateur…). Thierry Venin (qui, en plus de ses innombrables qualités, a également celle d’être le directeur de l’Agence départementale Numérique 64, dans laquelle je travaille 😉 ) donne dans sa thèse de nombreux exemples du coût que représente la multiplication du courrier électronique et surtout de l’image négative qu’en ont les utilisateurs, notamment en ce qui concerne le stress au travail. Il est probable que ce moyen de communication ne soit jamais payant, simplement parce que, désormais, plus personne ne serait disposé à payer pour elle, mais il est probable qu’à moyen terme il disparaîtra dans sa forme actuelle.
Ce qui reste à venir
Il existes des applications dotées d’une certaine forme d' »intelligence ». Je pense notamment à Siri sur iOS qui « comprend » des questions en langage naturel et leur trouve une solution. Je ne connais pas Siri, mais j’ai eu l’occasion de voir un peu fonctionner Google Now. Il se comporte à peu près comme l’agent intelligent de Théo, pour certaines choses simples. Par exemple, il me dit quand je dois partir avant un rendez-vous, en tenant compte des conditions de circulation du moment, m’indique le chemin à prendre pour m’y rendre. Il fait aussi des choses encore plus « intelligentes » (et qui font un peu peur, je l’avoue) ; voici un exemple (tiré d’une expérience réelle) : pour un déplacement à Paris, je note l’heure et l’adresse de la réunion dans mon agenda Google, je réserve un hôtel sur booking.com, qui m’envoie un email de confirmation. A mon arrivée à Paris, sans aucune action de ma part (à vrai dire, je n’avais activé ce service que par curiosité, sans comprendre à quoi il servait), un message sur mon téléphone m’annonce : « Vous êtes à Paris. Vous avez réservé un hôtel pour cette nuit. Voici l’itinéraire pour vous rendre à cet hôtel, vous y serez dans 40 minutes. » Il n’a pas manqué ensuite de me faire savoir l’heure de ma réunion et le chemin à suivre pour y aller. On approche de certaines fonctions de l’agent intelligent de Théo (jusque dans le zèle appliqué à lire les messages à la place de leur destinataire 😉 ). Toutefois, l’usage aussi systématique que dans l’histoire de Théo n’est pas encore généralisée et les applications restent encore assez rudimentaires.
Globalement, comme Eric Delcroix le fait remarquer, ce qui dans mon billet correspond le moins à la réalité actuelle est ce qui concerne le collège de mon jeune cobaye. J’avais bien raison d’écrire : « La plupart des cours se déroulent comme quand les parents de Théo étaient au collège ». Les cours en visio-conférence n’existent pas, à ma connaissance, autrement que sous forme d’expérimentations ici ou là (à vrai dire, je reste très perplexe sur l’efficacité de tels dispositifs). Ce sur quoi je pensais avoir peu de chance de me tromper est sans doute ce qui a le moins évolué depuis 2006 : il s’agit des ENT. Dans ce domaine, rien n’a changé en dix ans : ces systèmes sont ce qu’ils ont toujours été, des usines à gaz, rêves d’ingénieurs de ministère, dont la principale utilité semble être de faire fonctionner l’économie en poussant les collectivités à subventionner à fonds perdus toutes sortes de prestataires (éditeurs de logiciels, intégrateurs, hébergeurs, éditeurs de contenus…). Les avancées sont marginales et portent plutôt sur les infrastructures et le « back office », le côté utilisateur restant laid, peu ergonomique et indigent en termes de fonctionnalités.
Autre point étonnant : alors que les smartphones sont de plus en plus répandus dans la vie quotidienne de chacun, ils ne sont pas entrés dans les établissements scolaires. Que dis-je ? Alors que beaucoup d’élèves sont munis de cet outil qui pourrait leur permettre de faire beaucoup de choses en classe (prendre des notes, photographier des expériences, rechercher des informations etc.), le législateur a pris soin de s’assurer qu’ils ne pourraient pas en faire usage.
Je ne parle pas de tous les amusants dispositifs automatiques destinés à remplacer l’appel en classe, retrouver les élèves égarés etc. Nous en sommes loin (et ce n’est peut-être pas plus mal)…
Ce que je n’avais pas vu
Je suis peut-être pardonnable de ne pas avoir vraiment prévu deux éléments importants de la vie d’un collégien du futur (du présent en tout cas) : les tablettes et les réseaux sociaux.
En ce qui concerne les tablettes, il n’y a rien à dire, elles ne sont en rien différentes d’un smartphone dans leurs fonctionnalités.
Pour les réseaux sociaux, je n’avais pas imaginé leur existence en tant que tels, mais j’avais tout de même envisagé des fonctions qui sont désormais liées à ces outils : savoir quand un contact est à proximité, savoir comment un jeu vidéo est évalué par les autres joueurs, combien de contacts sont connectés à un moment donné etc.
Finalement, avec un peu plus de réseaux sociaux et, peut-être, en agrandissant un peu l’écran du smartphone de temps en temps, pour en faire une tablette (ceci dit, je persiste à penser que le smartphone est un outil très versatile et facile à transporter, beaucoup plus simple à utiliser et à « gérer » en classe), je maintiens à peu près ces prophéties pour l’échéance prévue.
Et vous, comment voyez-vous la vie d’un collégien dans 2 à 7 ans ?